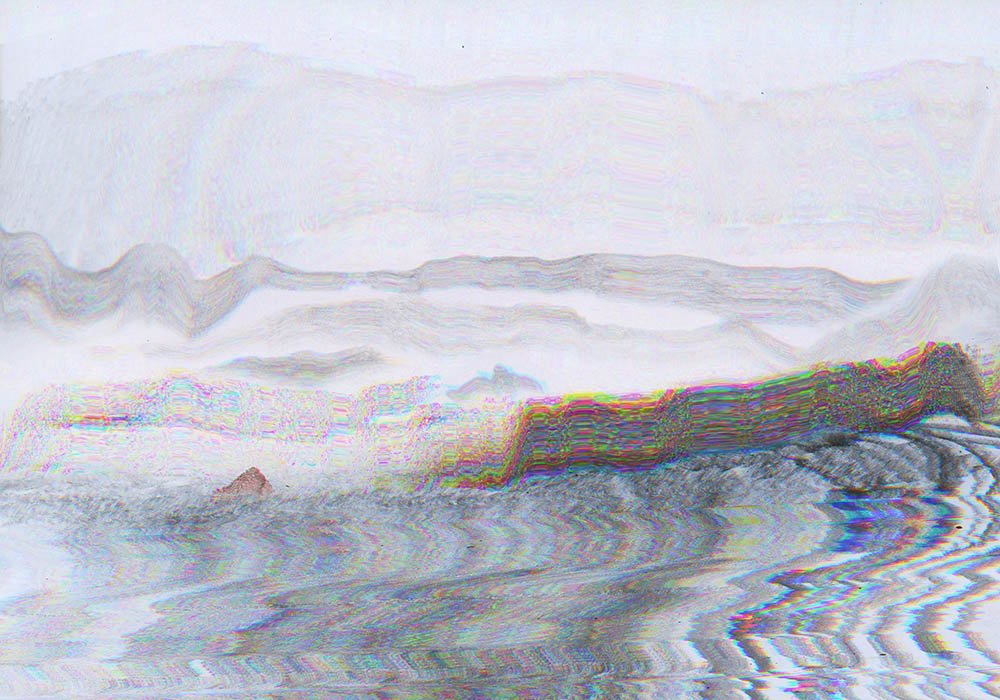Autre jour, autre roman. Des secousses pulsent dans l’air. Un grand ébranlement. La terre et les arbres ne sont plus sûrs de leurs racines, la pluie tombe avec le feu mais ne l’éteint pas. Pourtant le chant des cigales reprend de plus belle autour de moi, les vignes sont encombrées de feuilles, sarclées par le labour des sangliers, mais la pluie renverse le soleil, et dans toute la campagne défilent des paysans ; des hameaux et des granges, des bois et des garrigues, ils surgissent avec leurs fils et leurs pères. Ils vont vers les cyprès là-haut au village pour regarder leur tombe et les monuments à drapeaux armés de bronze. Habillés d’uniformes salis et déchirés, troués par des balles, ils ont pourri là où le monde s’est dévidé de son horreur. J’entends des hymnes et des silences, et c’est très vite de nouveau la pluie et la boue, c’est le vide encombré des tranchées, les médailles profanes et saintes, les manchots à mine grise, les visages gazés et les entrailles qu’on fouille, les rats. Je lis la guerre.
Autre jour encore, autre livre. Le temps s’est gâté au pays des mots. Une pluie plus froide et drue tombe à présent. Très vite les ruisseaux débordent, des sources crachent un peu partout comme de minuscules geysers leur eau micacée, les pinèdes et chênaies commencent à s’agiter. Surgira bientôt le monstre tueur, pathétique comme ces petits cachalots échoués dont on parle dans le journal local. Toute cette lumière possible, qui vient des grandes noirceurs, et vouée à se décomposer. Dans ce livre-là règne la puanteur de l’âme.
Il est temps, le vent se lève. Je ferme ma boîte à visions d’apocalypse. La pluie des mots a cessé. Je quitte le lavoir dans l’insouciance presque estivale du printemps qui fait déjà tomber les fleurs bleues sur le nom de Giono. Presque le nom d’un peintre. C’est la fin de la saison des asperges sauvages.
*
C’est l’été de la vie. Et je suis encore à califourchon sur le petit muret. Plus vraiment pour m’échapper mais pour écouter le silence de l’ange qui a parlé si fort en ce printemps des quinze ans. Couvrant le brouhaha des livres qui précipitaient dans la boue ou égaraient dans les campagnes que faucille l’apocalypse, c’est de la voix surtout dont je me souviens. Un jour, une fois a été dit : Écris, tu vas mourir jeune. Au printemps, je le sais maintenant, dans le brouillard que je cherchais à dissiper, déjà il travaillait son chemin dans les galeries secrètes. Désormais, il ne parle plus et montre quelque chose que je ne parviens pas à discerner, et qui remue. J’en ai mal au ventre, ça grossit, ça voudrait se déployer comme un houppier géant en des milliers d’espars, autant de mats et vergues pour gagner le large. Mais voici de nouveau le besoin de lumière noire qui appelle. L’apocalypse ? Ou est-ce la voix de l’ange que je ne sais plus reconnaître, parce qu’en plein été on voit trop net, parce qu’on ne vit plus dans le bruissement, parce qu’on sait trop de choses et qu’on n’écoute plus la houle inaudible au-delà du large, ni les rumeurs au-delà des collines, ni le ciel au-delà des étoiles ? Qu’importe, je reviens m’assoir près du lavoir. Il y a encore quelques fleurs et de tranquilles insectes aquatiques. Il y a des craquements et soubresauts dans les taillis. Et aussi le nom d’un intercesseur. Je suis surpris de le retrouver en cet été de ma vie : le même qui faisait lever les campagnes et l’aventure, qui fouillait la guerre ou le mal choléra, présente le matelot Herman. Connaître un écrivain par un autre est une double joie. Ce n’est plus l’intimité d’une amitié mais ce cercle d’un nous plus large qui se forme. Le livre est ouvert – celui de la grande baleine – et tout se met à vaciller. Pas comme au printemps, dans cette vision de feu et d’eau, de cendres et de morts au champ d’honneur, qui attendent je ne sais quelle résurrection à laquelle je ne crois plus. Non, devant, c’est une autre aventure. Il n’est pas question de contrées lointaines ni de chasses au grand air. Il est clair que les baleines, ce sont d’abord des livres. Je le sais depuis longtemps. Depuis que la voix a dit : Ecris, tu vas mourir jeune. L’ange n’avait pas d’ailes et n’ébouriffait pas avec ses accès lyriques, mais il était une présence impérative, impossible à contredire, ni glaçante ni chaleureuse, une évidence précipitant sur un filin d’acier au-dessus du vide comme un funambule. Devoir écrire est un des signes de l’apocalypse. Terrifiante injonction. Je sais que le corps devra passer par des épreuves très grandes, que c’est de là que viennent les mots, quand ils viennent, de cette furie que déclenchent le danger et les mots obscurs eux-mêmes qui en dégorgent. Je sais en lisant Melville que je ne suis pas encore embarqué pour le grand voyage. Je le sais même si j’ignore quel il sera. J’attends qu’un livre souffle en moi. Que la trappe du monde se soulève et que j’entrevoie enfin les entrailles du vrai, que je tombe dans la tête puante de la baleine et que j’y gratte à la petite cuillère l’huile précieuse. C’est le tout début de l’été. Je n’ai encore rien fait de ma vie.
*
Et me voici quelques années plus tard. Moi aussi j’ai affronté un étrange monstre. Et senti mon corps livré à ce vassal du soleil qui surgissait des profondeurs de mon destin. De cette terreur-là j’ai réchappé. J’y ai laissé non pas une jambe, moins que cela et beaucoup plus. Je suis revenu, et pas tout à fait. Mais j’ai été caressé par l’ange. Cette fois j’étais prêt. J’ai obéi. Depuis j’ai écrit quelques livres. Et je peux m’asseoir comme autrefois, sur le muret près du lavoir – hors des saisons. Pour saluer Melville et Giono ensemble, pour remercier des hommes grâce à qui je me suis senti moins seul au large, je suis venu honorer cet essai qui glisse doucement vers le roman, devient conte de sorcier et amène à vous la ligne immatérielle qu’on franchit avec un bruit imperceptible et vous conduit de l’autre côté, près de la grande baleine tranquille du temps de paix, amoureux de cette beauté qui permet de mieux vivre, cette baleine aussi blanche que la terrifiante baleine, mais qui elle entraîne avant tout vers soi-même. J’ai écrit les livres que je devais, j’attends ce qui doit commencer. Est-ce la violente menace que je cherche, approcher encore le gouffre ? Les symboles sont des leurres. Qui a frôlé la mort sait bien cela. Qui en a réchappé se méfie des espoirs et des promesses. Il sait qu’elle ne surgit pas forcément là où elle souffle. Qui a frôlé la mort est boiteux devant les signes du monde. Boiteux et léger aussi de n’avoir pas à supporter la carapace méticuleuse des certitudes. Mais à califourchon sur le muret, j’attends que s’agitent en moi ces ailes impératives, comme il est arrivé à Melville avant qu’il ait écrit Moby Dick, dit Giono, pour le pousser vers un autre voyage, une autre chasse que les livres à succès qu’il vient de publier, une aventure plus grandiose que celle du passé. Non plus écrire les petits livres qu’il sait faire car l’œuvre n’a d’intérêt que si elle est un perpétuel combat avec le large inconnu. À soi de se construire ses compas et sa voilure: Le jeu, c’est de toujours partir pour tout perdre ou pour tout gagner. Oui, moi aussi j’attends le livre béant qui s’agite. Au bord de l’aventure, me voici sur le point de plonger vers ce nouveau, vers ce qui tournicote comme une nymphe presque mûre de cigale, qui n’a pu encore rejoindre le jour. Et avec au ventre la crainte, comme Melville, d’atteindre à présent la couche la plus profonde du bulbe et que bientôt la fleur se flétrira. On ne sait jamais, quand on écrit un livre, si on est le jeune mélancolique Ismaël ou le furieux Achab. Les deux sans doute. Alors, peut-être un amour bref et puissant, comme celui offert à Melville (Giono du moins le transpose cet amour-là), viendra rompre les amarres. Ou quelque autre séisme, ou rien au contraire, sinon la paix silencieuse des jours sans événements. Giono semble prévenir que l’ange a plus d’attentes, et qu’il faudra quitter la complicité et l’amour pour rentrer chez soi, où l’on s’assiéra à son bureau en regardant le mont par la fenêtre, à Pittsfield ou à Manosque, ou ailleurs. Qu’importe le nom des arbres, de la colline ou du pays qui se dresseront devant soi. Seul comptera le grand labeur où on pourra plonger et mourir qui sait. Chaque livre coûte très cher. Chacun des miens a exigé un morceau de mon corps. A pound of flesh. Mais tant pis, je me suis rembarqué pour devenir compagnon des innocents oiseaux hauturiers. Et déjà je sais que, dans ces mers incertaines, j’aurai besoin d’envergure et aussi des grands corps qui habitent le tumulte et le froid ; j’aurai besoin des yeux du monde, qui savent sans peur contempler le ciel au-delà des étoiles, et de ce radeau d’écriture où l’on survit dans le dépouillement, dans le désert, mais devant le grand autre. Même si là, tout au fond de la mer en moi, je sais que vivent le lavoir et la glycine, les fleurs fanées sur l’eau et les insectes grouillant, les sangliers qui la nuit mangent les raisins et déterrent les vers, les cétoines et légions de mouches sur les fruits et fleurs sucrées, la pluie et les sources brillantes, la boue encore et encore, et ces tombes oubliées que recouvre la terre tranquille.
Mais je crois que, dans cette aventure, les abîmes auront rejoint la surface houleuse des collines. L’ange ne m’aura pas trompé. Et le corps entier glissé dans la gueule de mon livre nouveau, là où tonnent ces formidables combats dans lesquels on est seul engagé et dont le tumulte est silence pour le reste du monde, je pourrai parler enfin le langage des geais et des petites girelles, celui de l’argile et des vagues, celui surtout des cigales écloses de la bouche des morts afin de célébrer la joie de la paix solaire.